ECTS
60 crédits
Composante(s)
UFR Humanités
Présentation
Télécharger le fichier "Guide S5-S6 Babel 25-26"
Consultez bien votre emploi du temps après la semaine des partiels, pour vérifier si vous avez des CM de l’UFR de Langues qui commencent la semaine du 8 Septembre.
Vous ne pouvez pas changer de langue en cours d’année.
Vous ne pouvez pas passer dans un niveau inférieur en langue, mais vous pouvez demander à passer dans le niveau supérieur, si vous avez le sentiment de vous être ennuyé au premier semestre. Rendez-vous alors au Centre de langues pour demander un changement de groupe : bâtiment A, 1er étage.
En cas de superposition de cours de langue le soir, ou d’impossibilité majeure d’assister à un cours du soir, vous pouvez demander à changer de groupe (si d’autres groupes existent), en passant toujours par le centre de langues, bât. A, 1er étage.
Rappels : gestionnaire de la licence :
Manon Villanova
Manon.villanova@u-bordeaux-montaigne.fr
Bureau I218
Si vos cours n’apparaissent pas au complet à partir du 9 septembre (pas avant) dans votre planning en ligne, veuillez vous rendre au bureau de Nolwenn LEPLAT, responsable des plannings :
Bureau I209
Sauf pour les cours de langue (> Centre de langues, bât. A, 1er étage).
Les résultats du premier semestre seront diffusés le 23 février. Les copies de partiels seront consultables entre le 27 février et le 3 mars (précisions ultérieurement).
Compétences
Bloc de compétences disciplinaires
Bloc de compétences transversales
Bloc de compétences préprofessionnelles
Tableau des compétences
| Semestre | Semestre 5 L3 Lettres BABEL : langues et cultures du monde | Semestre 6 L3 Lettres BABEL : langues et cultures du monde | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unité d'Enseignement | Plurilinguisme et traduction | Littérature | Langue et culture | Anglais | Spécialisation | Plurilinguisme et traduction | Littérature | Anglais | Langues et cultures du monde | Spécialisation | |
| Bloc de compétences disciplinaires | 432 Mobiliser les concepts de la théorie littéraire et une culture personnelle pour lire et interpréter des textes de nature, d'origine et d'époque diverses (de l'Antiquité gréco-latine jusqu'à l'époque contemporaine) | x | x | x | x | ||||||
| 560 Se servir aisément des structures, de l’évolution et du fonctionnement de la langue française et d’au moins une langue vivante étrangère (avec des éléments de langues anciennes) pour analyser des discours oraux et des productions dans ces deux langues, y compris liés aux nouveaux modes de communication | x | x | x | x | x | ||||||
| 559 Se servir aisément des outils linguistiques permettant une communication et une compréhension de toute forme de discours (oral, directement produit ou enregistré, écrit, rapport, correspondance, information, essai, production littéraire …), dans différents contextes et ce dans la langue maternelle et dans la ou les langues visées | x | x | x | x | x | ||||||
| 406 Mobiliser des concepts dans les domaines linguistiques de la langue française et de la langue étrangère visée pour la relation et le transfert entre différentes aires culturelles | x | x | x | x | |||||||
| 290 Identifier et situer dans leur contexte des productions culturelles et artistiques diverses (littérature, beaux-arts, musique, théâtre, cinéma, multimédias) en lien avec les genres et grands courants littéraires, dans une perspective à la fois historique et comparatiste (les resituer à l’échelle de la France, de l’Europe et du monde) | x | x | x | x | x | ||||||
| 472 Produire des études critiques de documents écrits dans différentes perspectives (rédaction de synthèse, études stylistiques ou argumentatives) dans différents champs et époques historiques | x | x | x | x | x | ||||||
| 491 Repérer l’organisation institutionnelle, administrative et associative de la gestion, de la conservation et du commerce des productions artistiques ou création du domaine concerné | x | x | x | ||||||||
| Bloc de compétences transversales | 289 Identifier et sélectionner diverses ressources spécialisées pour documenter un sujet | x | x | ||||||||
| 022 Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation | x | x | |||||||||
| 184 Développer une argumentation à l'écrit comme à l'oral et analyser avec esprit critique diverses ressources dans son domaine de spécialité | x | ||||||||||
| 061 Communiquer à des fins de formation ou de transfert de connaissances, lors d'échanges professionnels, par oral et par écrit, en français | x | x | |||||||||
| 062 Communiquer à des fins de formation ou de transfert de connaissances, lors d'échanges professionnels, par oral et par écrit, en français et dans au moins une langue étrangère | x | x | |||||||||
| Bloc de compétences préprofessionnelles | 296 Identifier le processus de production, de diffusion et de valorisation des savoirs, les champs professionnels et les parcours possibles pour y accéder | x | x | x | |||||||
| 495 Respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale | x | x | x | ||||||||
| 580 Travailler en équipe autant qu'en autonomie ou en réseau au service de projets nécessitant prise d'initiatives, respect de principes déontologiques et capacité d'adaptation | x | x | x | ||||||||
| 294 Identifier et situer les champs professionnels potentiellement en relation avec les acquis de la formation ainsi que les parcours possibles pour y accéder | x | x | x | ||||||||
| 056 Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet professionnel en fonction d’un contexte et identifier le processus de production, de diffusion et de valorisation des savoirs | x | x | x | ||||||||
| 543 Savoir s'auto-évaluer et se remettre en question | x | x | x | ||||||||
| 006 Acquérir la capacité de comparer des langues à travers des classements typologiques et élargir le regard sur la linguistique à travers la prise en compte de disciplines connexes | x | x | |||||||||
| 299 Identifier les débouchés professionnels et se préparer à l'insertion au marché du travail | x | x | |||||||||
| 573 Situer son rôle et sa mission au sein d'une organisation pour s’adapter et prendre des initiatives | x | ||||||||||
Organisation
Emploi du temps du Semestre 6 :
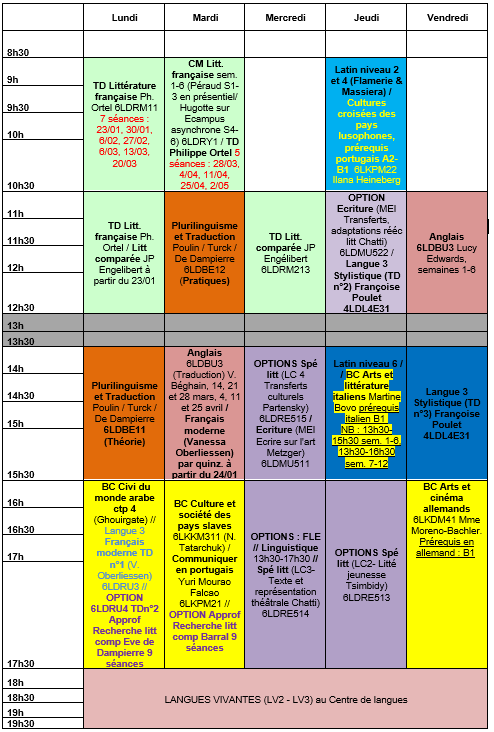
Programme
Plurilinguisme et traduction
6 créditsThéories du plurilinguisme
3 créditsPratiques de la traduction et intermédialité
3 crédits
Littérature
6 créditsLangue et culture
9 créditsLangue 2
3 créditsLangue 3
3 créditsAu choix : 1 parmi 22
Roumain S5
3 créditsChinois S5
3 créditsTurc S5
3 créditsLangues des signes S5
3 créditsSuédois S5
3 créditsCatalan S5
3 créditsPolonais S5
Arabe S5
Japonais S5
Serbo-croate S5
3 créditsGrec moderne S5
Italien S5
Persan S5
3 crédits5LDRM511- Programme 1 Langue et culture latines
3 créditsAllemand S5
Basque S5
3 créditsCoréen S5
3 créditsVietnamien S5
3 créditsTchèque S5
3 créditsOccitan S5
Espagnol S5
Russe S5
Culture
3 crédits
Anglais
3 créditsSpécialisation
6 créditsAu choix : 1 parmi 5
Littérature et culture ou latin
6 créditsAu choix : 2 parmi 3
PRE-PROFESSIONNALISATION - PARCOURS : Linguistique générale
6 créditsEcrire sur l'art et littérature et patrimoine
6 créditsLittérature et patrimoine
3 créditsEcrire sur l'art
3 crédits
PRE-PROFESSIONNALISATION - PARCOURS : didactique du FLES
6 créditsJournalisme
6 crédits
Plurilinguisme et traduction
6 créditsThéories du plurilinguisme
3 créditsPratiques de la traduction et intermédialité
3 crédits
Littérature
6 créditsAnglais
3 créditsLangues et cultures du monde
9 créditsLangue 2
3 créditsCultures du monde
3 créditsAu choix : 1 parmi 5
Langue 3
3 créditsAu choix : 1 parmi 22
Serbo-croate S6
3 créditsBasque S6
3 créditsItalien S6
Japonais S6
3 créditsLangues des signes S6
3 crédits6LDRM511 Programme 1 Langue et culture latines
Russe S6
Vietnamien S6
3 créditsSuédois S6
3 créditsArabe S6
Persan S6
3 créditsPolonais S6
Tchèque S6
3 créditsTurc S6
3 créditsEspagnol S6
Catalan S6
3 créditsCoréen S6
3 créditsGrec moderne S6
Occitan S6
Roumain S6
3 créditsAllemand S6
Chinois S6
3 crédits
Spécialisation
6 créditsAu choix : 1 parmi 4
Littérature et culture ou latin
6 créditsAu choix : 2 parmi 3
Ecrire sur l'art et transfert, adaptations
6 créditsEcrire sur l'art
3 créditsTransferts, adaptations, réécriture littéraires
3 crédits
PRE-PROFESSIONNALISATION - PARCOURS : didactique du FLES
6 créditsPRE-PROFESSIONNALISATION - PARCOURS : Linguistique générale
6 crédits
Plurilinguisme et traduction
ECTS
6 crédits
Composante(s)
UFR Humanités
Période de l'année
Semestre 5
Théories du plurilinguisme
ECTS
3 crédits
Composante(s)
UFR Humanités
Période de l'année
Semestre 5
Pratiques de la traduction et intermédialité
ECTS
3 crédits
Composante(s)
UFR Humanités
Période de l'année
Semestre 5
Littérature
ECTS
6 crédits
Composante(s)
UFR Humanités
Période de l'année
Semestre 5
Littérature française et francophone
Composante(s)
UFR Humanités
Période de l'année
Semestre 5
Littérature XVIe-XVIIIe siècles / Aux frontières de la littérature
Dans cette UE, on s’interrogera sur la manière dont, sous l’Ancien Régime (XVIe-XVIIIe siècles), les lecteurs et théoriciens définissent la littérature, ses frontières et ses rapports avec les textes et discours non littéraires.
L’organisation des cours est la suivante :
Le CM, commun aux divers groupes de cette UE mutualisée, est au format « tout numérique ». Il prend la forme d’un document rédigé, qui sera disponible sur e-campus dès le début du semestre.
TD : un total semestriel de 36h, réparties selon les groupes en :
- une séance de 3h par semaine,
- ou une séance de 2h chaque semaine, plus une séance de 2h tous les 15 jours.
Le CM dispense un enseignement théorique et un socle de connaissances en histoire littéraire sur une question d’ensemble illustrée par un programme d’œuvres spécifique à chaque groupe de TD.
Les TD, dont les programmes sont indiqués ci-dessous, sont consacrés à l’étude des textes et à la méthodologie de l’exercice écrit de la dissertation (recherche et organisation des idées, mise en forme de l’argumentation, plan, rédaction). Les TD offrent aussi l’occasion de pratiquer l’oral (exposés, commentaires de textes). Les œuvres au programme se prêtent à une réflexion théorique générale sur la définition de la littérature, ses frontières et sa porosité à d’autres discours (récit historique, discours savants…).
Retrouvez le programme de Littérature des L3 Lettres Classiques ici : PDF
Littérature comparée
Composante(s)
UFR Humanités
Période de l'année
Semestre 5
ECUE Littérature comparée : liste à choix (Crédits ECTS pour l’ECUE : 4)
ECUE : 5LDRM211 « Littérature comparée Programme 1 - L’héritage de Déméter : femmes-terre, femmes-nourricières ? »
ECUE 5LDRM212 « Littérature comparée Programme 2 - Face au langage »
ECUE 5LDRM213 Littérature comparée programme 3 - Devenirs du couple romanesque dans le roman occidental
ECUE 5LDRE21F Littérature comparée FAD : Devenir du roman gothique
Littérature comparée 1
Composante(s)
UFR Humanités
Période de l'année
Semestre 5
5LDRM211 Littérature comparée.
Programme 1. L’héritage de Déméter : femmes-terre, femmes-nourricières ?
Une femme qui se dévoue pour les autres, qui tient les liens de la famille et de la communauté, qui prend soin des enfants, des aînés et des malades, qui s’occupe de la maison et des tâches domestiques, telle est l’image traditionnelle des femmes depuis l’Antiquité. Elle s’accompagne d’une symbolique plus diffuse, qui relie les femmes à la nature, au cycle des saisons, à la fertilité de la terre. Cette image s’est nourrie de textes littéraires grecs qui ont donné ses traits à la figure de la femme nourricière, particulièrement « l’Hymne à Déméter », attribué à Homère. Tel est le socle dont nous étudierons l’héritage littéraire, religieux et philosophique, mais aussi les reprises militantes, notamment sa constitution en mythe féministe, et éco-féministe.
Derrière ce que la postérité a retenu de ces images d’un féminin lié à la terre, au cycle, à la fertilité et au vivant, il existe non seulement d’autres figures féminines présentes dans les textes antiques, qui peuvent aussi symboliser le mal, l’abstraction ou le politique, mais aussi d’autres traits présents dans les textes mêmes qui servent de socle à la définition de la femme nourricière. On reprendra donc les textes antiques, à partir d’Homère et d’Hésiode, pour chercher ce qui en eux déborde autant la vision stéréotypée de la femme antique forgée par les siècles ultérieurs, que les relectures qui en sont faites aujourd’hui au nom d’une certaine vision du féminisme.
On étudiera la figure de la femme nourricière dans différents contextes culturels : l’Antiquité grecque, avec le mythe de Perséphone dans l’Hymne à Déméter du pseudo-Homère, l’Amérique des années 1920 dans Sula de Toni Morrison, et la France contemporaine avec Ladivine de Marie Ndiaye. Nous pourrons alors analyser différents visages du féminin : mère, fille, épouse, amante, célibataire, servante, serveuse, nourrice, institutrice, femme au foyer, déesse, sorcière. Cette variété de figures nous permettra de nous demander s’il existe une façon féminine de se rapporter aux autres (maris, enfants, amies, société), et d’en prendre soin, ainsi que de se penser comme un individu. On cherchera alors à faire apparaitre quelles conceptions d’un « mode féminin d’être » sont mobilisées dans ces représentations, et dans quelle mesure elles sont déterminées par les conceptions d’un naturel féminin, de la culture, de l’éducation, ou d’un contexte. On verra s’esquisser un croisement des lignes de lecture, qui inscrit les femmes dans des catégories présentes dès les textes antiques : sexe, âge, « classe » et « race » - nous réfléchirons à l’usage de ces deux termes.
Notre lecture nous offrira l’occasion de réfléchir autant à l’herméneutique qu’à la définition de la littérature. D’une part, nous essaierons de tracer la frontière toujours mobile entre ce qui est projeté de façon anachronique par les constructions critiques et ce qui résiste dans les textes.
D’autre part, nous chercherons aussi à cerner ce qui fait le propre de la littérature, par rapport à des textes historiques, ethnologiques ou sociologiques. Ni un document, ni un discours porteur de « messages », l’œuvre littéraire nous offre l’espace pour déployer une réflexion complexe, et ouverte, sur la place des femmes et la construction de leurs identités.
Au-delà de ces analyses et de ces pistes de réflexion, nous nous demanderons dans quelle mesure la littérature nous permet de découvrir, d’expérimenter, de penser, de comprendre, d’imaginer et d’inventer aussi, d’autres vies que les nôtres.
Nous travaillerons sur « l’Hymne à Déméter » du pseudo-Homère, publié dans les Hymnes (trad. Jean Humbert, Les Belles Lettres, 1936, rééd : 1997). Comme le volume de la collection Budé peut être onéreux pour des budgets étudiants, commencez par lire les traductions disponibles en ligne : « Hymne à Cérès », par Ernest Falconnet en 1845 et « Hymne à Déméter », par Charles Leconte de Lisle.
Je proposerai un exemplaire du texte en version bi-langue sur e-campus.
Littérature comparée 2
Composante(s)
UFR Humanités
Période de l'année
Semestre 5
5LDRM212 Littérature comparée.
Programme 2 : Face au langage
Enseignante : Céline Barral
Nous travaillerons sur l’œuvre de deux auteurs qui ne se sont ni connus ni lus : Karl Kraus (mort en 1936) et Valère Novarina (né en 1942). Tous deux ont mis sur la scène du théâtre un langage qui n’est plus porté par des personnages ni une action dramatique, mais qui s’expose à nu, comme machine ou organisme traversé de matériaux intertextuels, de langues, de dialectes et de sociolectes, et qui semble nous précipiter vers l’Apocalypse. Ces deux « théâtres du verbe » ont quelque chose d’antithéâtral et de monstrueux. Mais ce manège du langage est rythmé par des inspirations communes : l’Apocalypse de Jean, et la veine tragique de Shakespeare, d’une part ; l’opérette et le cabaret, et la verve comique, d’autre part. Derrière cet allant satirique, les masques à gaz des millions de morts de la Grande guerre, et le masque mortuaire du comédien disparu font de ces pièces des méditations sur la mort et la finitude de l’homme.
Nous analyserons ces deux pièces en nous intéressant particulièrement à leur devenir au cours du temps, au fil des remaniements successifs de leur composition par les deux auteurs ; aux problèmes de traduction et de mise en scène qu’elles suscitent ; et aux conceptions du langage qu’elles mettent en acte.
Littérature comparée 3
Composante(s)
UFR Humanités
Période de l'année
Semestre 5
5LDRM213 Littérature comparée.
Programme 3 : Devenirs du couple romanesque dans le roman occidental
Enseignant : Antoine Ducoux
On connaît les tristement célèbres couples passionnels de la littérature : Tristan et Iseut, Roméo et Juliette, Catherine et Heathcliff… ou la variante de ce motif, le couple criminel (Valmont et Merteuil, Macbeth et sa femme…) Si la thématique du couple malheureux est récurrente dans l’histoire littéraire, d’autres romans explorent de façon toute différente la question du couple et de la vie à deux. La représentation romanesque du couple, et particulièrement de la conjugalité, soulève toutes sortes de questions sociales et politiques dont l’actualité n’est plus à démontrer : l’institution sociale du mariage et ses transformations dans l’histoire, la domination masculine, l’émancipation féminine, la place et la fonction que la société attribue au couple… À travers trois romans d’amour figurant au canon de la littérature occidentale, nous étudierons les variations des topiques du récit amoureux et nous poserons les questions suivantes : à quels modèles implicites, mythologiques, littéraires et culturels, ces romans répondent-ils ? comment leurs auteurs traitent-ils les « scripts » imposés de la relation amoureuse ? À propos, écrit-on différemment sur le couple quand on est un auteur ou une autrice ? Nous prêterons une attention particulière aux paradoxes que soulève la représentation romanesque du couple : l’idéal chevaleresque est-il compatible avec la vie conjugale ? À quel prix une jeune femme de la société anglaise marchande-t-elle sa liberté dans le mariage ? Comment le destin d’un couple peut-il refléter celui d’un pays occupé ? Nous déchiffrerons les réponses que les romanciers et romancières apportent à ces questions à travers la mise en débat des discours sur l’amour, le jeu narratif sur la variation des points de vue. Ce cours s’adressant à des étudiant-es spécialisé-es en lettres et langues, nous ne perdrons pas de vue le questionnement proposé par ces œuvres sur la langue et sur les mots de l’amour.
Langue et culture
ECTS
9 crédits
Composante(s)
UFR Humanités
Période de l'année
Semestre 5
Langue 2
ECTS
3 crédits
Composante(s)
UFR Humanités
Période de l'année
Semestre 5
Polonais S5
Composante(s)
UFR Langues et Civilisations
Période de l'année
Semestre 5
Langue polonaise : initiation ou consolidation.
Arabe S5
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 5
Arabe débutant A1 semestre 5
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 5
Arabe intermédiaire B1 semestre 5
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 5
Arabe consolidation A2 semestre 5
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 5
Arabe avancé B2 semestre 5
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 5
Grec moderne S5
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 5
Grec moderne consolidation A2 semestre 5
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 5
Grec moderne débutant A1 semestre 5
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 5
Grec moderne intermédiaire B1 semestre 5
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 5
Grec moderne avancé B2 semestre 5
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 5
Italien S5
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 5
Italien intermédiaire B1 semestre 5
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 5
Italien avancé B2 semestre 5
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 5
Italien consolidation A2 semestre 5
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 5
Italien débutant A1 semestre 5
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 5
Italien expert C1 semestre 5
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 5
Communiquer en portugais 5
Composante(s)
UFR Langues et Civilisations
Période de l'année
Semestre 5
Il s’agira de mettre l’accent sur des activités amenant l’étudiant à produire des textes complexes, argumentatifs et s’exprimer aisément sur des sujets de plus en plus variés.
Allemand S5
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 5
Allemand consolidation A2 semestre 5
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 5
Allemand avancé B2 semestre 5
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 5
Allemand expert C1 semestre 5
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 5
Allemand débutant A1 semestre 5
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 5
Allemand intermédiaire B1 semestre 5
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 5
Espagnol S5
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 5
Espagnol avancé B2 semestre 5
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 5
Espagnol intermédiaire B1 semestre 5
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 5
Espagnol débutant A1 semestre 5
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 5
Espagnol expert C1 semestre 5
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 5
Espagnol consolidation A2 semestre 5
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 5
Russe S5
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 5
Russe consolidation A2 semestre 5
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 5
Russe intermédiaire B1 semestre 5
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 5
Russe avancé B2 semestre 5
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 5
Russe débutant A1 semestre 5
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 5
Langue 3
ECTS
3 crédits
Composante(s)
UFR Humanités
Période de l'année
Semestre 5
Roumain S5
ECTS
3 crédits
Composante(s)
Scolarité
Période de l'année
Semestre 5
Chinois S5
ECTS
3 crédits
Composante(s)
UFR Langues et Civilisations
Période de l'année
Semestre 5
Chinois consolidation A2 semestre 5
Composante(s)
UFR Langues et Civilisations
Période de l'année
Semestre 5
Chinois intermédiaire B1 semestre 5
Composante(s)
UFR Langues et Civilisations
Période de l'année
Semestre 5
Chinois débutant A1 semestre 5
Composante(s)
UFR Langues et Civilisations
Période de l'année
Semestre 5
Turc S5
ECTS
3 crédits
Composante(s)
Scolarité
Période de l'année
Semestre 5
Langues des signes S5
ECTS
3 crédits
Composante(s)
Scolarité
Période de l'année
Semestre 5
Suédois S5
ECTS
3 crédits
Composante(s)
Scolarité
Période de l'année
Semestre 5
Catalan S5
ECTS
3 crédits
Composante(s)
Scolarité
Période de l'année
Semestre 5
Polonais S5
Composante(s)
UFR Langues et Civilisations
Période de l'année
Semestre 5
Langue polonaise : initiation ou consolidation.
Arabe S5
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 5
Arabe débutant A1 semestre 5
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 5
Arabe intermédiaire B1 semestre 5
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 5
Arabe consolidation A2 semestre 5
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 5
Arabe avancé B2 semestre 5
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 5
Japonais S5
Composante(s)
UFR Langues et Civilisations
Période de l'année
Semestre 5
Japonais débutant A1 semestre 5
Composante(s)
UFR Langues et Civilisations
Période de l'année
Semestre 5
Japonais consolidation A2 semestre 5
Composante(s)
UFR Langues et Civilisations
Période de l'année
Semestre 5
Japonais intermédiaire B2 semestre 5
Composante(s)
UFR Langues et Civilisations
Période de l'année
Semestre 5
Japonais intermédiaire B1 semestre 5
Composante(s)
UFR Langues et Civilisations
Période de l'année
Semestre 5
Serbo-croate S5
ECTS
3 crédits
Composante(s)
UFR Langues et Civilisations
Période de l'année
Semestre 5
Langue serbo-croate : initiation ou consolidation.
Grec moderne S5
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 5
Grec moderne consolidation A2 semestre 5
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 5
Grec moderne débutant A1 semestre 5
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 5
Grec moderne intermédiaire B1 semestre 5
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 5
Grec moderne avancé B2 semestre 5
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 5
Italien S5
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 5
Italien intermédiaire B1 semestre 5
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 5
Italien avancé B2 semestre 5
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 5
Italien consolidation A2 semestre 5
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 5
Italien débutant A1 semestre 5
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 5
Italien expert C1 semestre 5
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 5
Persan S5
ECTS
3 crédits
Composante(s)
Scolarité
Période de l'année
Semestre 5
5LDRM511- Programme 1 Langue et culture latines
ECTS
3 crédits
Composante(s)
UFR Humanités
Période de l'année
Semestre 5
- Langue et culture latines -
(cliquez sur le - bouton rouge - pour télécharger le descriptif du programme de l’année universitaire 2022-2023).
Loisirs et littérature à Rome
Intervenante : Anne Bajard
Allemand S5
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 5
Allemand consolidation A2 semestre 5
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 5
Allemand avancé B2 semestre 5
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 5
Allemand expert C1 semestre 5
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 5
Allemand débutant A1 semestre 5
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 5
Allemand intermédiaire B1 semestre 5
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 5
Basque S5
ECTS
3 crédits
Composante(s)
Scolarité
Période de l'année
Semestre 5
Coréen S5
ECTS
3 crédits
Composante(s)
UFR Langues et Civilisations
Période de l'année
Semestre 5
Coréen intermédiaire B1 semestre 5
Composante(s)
UFR Langues et Civilisations
Période de l'année
Semestre 5
Coréen consolidation A2 semestre 5
Composante(s)
UFR Langues et Civilisations
Période de l'année
Semestre 5
Coréen débutant A1 semestre 5
Composante(s)
UFR Langues et Civilisations
Période de l'année
Semestre 5
Vietnamien S5
ECTS
3 crédits
Composante(s)
Scolarité
Période de l'année
Semestre 5
Tchèque S5
ECTS
3 crédits
Composante(s)
UFR Langues et Civilisations
Période de l'année
Semestre 5
Langue tchèque : initiation ou consolidation.
Occitan S5
Composante(s)
UFR Langues et Civilisations
Période de l'année
Semestre 5
Espagnol S5
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 5
Espagnol avancé B2 semestre 5
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 5
Espagnol intermédiaire B1 semestre 5
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 5
Espagnol débutant A1 semestre 5
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 5
Espagnol expert C1 semestre 5
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 5
Espagnol consolidation A2 semestre 5
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 5
Russe S5
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 5
Russe consolidation A2 semestre 5
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 5
Russe intermédiaire B1 semestre 5
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 5
Russe avancé B2 semestre 5
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 5
Russe débutant A1 semestre 5
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 5
Culture
ECTS
3 crédits
Composante(s)
UFR Humanités
Période de l'année
Semestre 5
Cinéma
Composante(s)
UFR Langues et Civilisations
Période de l'année
Semestre 5
Lecture et analyse d’œuvres cinématographiques en langue allemande.
Histoire et civilisations arabes
Composante(s)
UFR Langues et Civilisations
Période de l'année
Semestre 5
Sociologie italienne
Composante(s)
UFR Langues et Civilisations
Période de l'année
Semestre 5
Séminaires sur des phénomènes sociétaux.
Cultures croisées des pays de langue portugaise 3
Composante(s)
UFR Langues et Civilisations
Période de l'année
Semestre 5
Cours dédié aux cultures des pays de l'Afrique lusophone.
Littérature italienne
Composante(s)
UFR Langues et Civilisations
Période de l'année
Semestre 5
Découverte de moments et figures clés de la littérature italienne antique et pré-moderne.
Cultures du Japon 3
ECTS
3 crédits
Composante(s)
UFR Langues et Civilisations
Période de l'année
Semestre 3
Cours neutralisé pour l'année 2022-2023
Civilisation des pays slaves
Composante(s)
UFR Langues et Civilisations
Période de l'année
Semestre 5
Étude approfondie des civilisations des pays slaves.
Anglais
ECTS
3 crédits
Composante(s)
UFR Humanités
Période de l'année
Semestre 5
Spécialisation
ECTS
6 crédits
Composante(s)
UFR Humanités
Période de l'année
Semestre 5
Littérature et culture ou latin
ECTS
6 crédits
Composante(s)
UFR Humanités
Période de l'année
Semestre 5
5LDRM511- Programme 1 Langue et culture latines
ECTS
3 crédits
Composante(s)
UFR Humanités
Période de l'année
Semestre 5
- Langue et culture latines -
(cliquez sur le - bouton rouge - pour télécharger le descriptif du programme de l’année universitaire 2022-2023).
Loisirs et littérature à Rome
Intervenante : Anne Bajard
5LDRM513- Programme 3 Bible et littérature
ECTS
3 crédits
Composante(s)
UFR Humanités
Période de l'année
Semestre 5
- Bible et littérature -
(cliquez sur le - bouton rouge - pour télécharger le descriptif du programme de l’année universitaire 2022-2023).
Proust et la Bible
Intervenant : Sophie Duval
5LDRM512- Programme 2 Littérature francophone
ECTS
3 crédits
Composante(s)
UFR Humanités
Période de l'année
Semestre 5
- Littérature francophone -
(cliquez sur le - bouton rouge - pour télécharger le descriptif du programme de l’année universitaire 2022-2023).
Le « roman familial » maghrébin
Intervenante : Mounira Chatti
PRE-PROFESSIONNALISATION - PARCOURS : Linguistique générale
ECTS
6 crédits
Composante(s)
UFR Langues et Civilisations
Période de l'année
Semestre 5
Linguistique de la langue des signes
Composante(s)
UFR Langues et Civilisations
Période de l'année
Semestre 5
La langue des signes, reconnue officiellement depuis peu, pose de nombreux défis pour les recherches linguistiques : son canal visuo-gestuel, son vocabulaire et sa grammaire en trois dimensions obligent à reconsidérer certains concepts et outils prévus pour les langues vocales.
Ce cours présentera ces recherches et les outils développés : espace de signation, transferts, classificateurs…
Seront également abordées les questions touchant à l’écriture de la langue des signes, à son enseignement, à l’histoire, la communauté linguistique et la culture sourdes, à la philosophie et la politique linguistiques.
Approches comparatives et typologiques des langues
Composante(s)
UFR Langues et Civilisations
Période de l'année
Semestre 5
Le présent cours développe et conjugue deux approches à la diversité linguistique, à la fois distinctes et complémentaires :
- une approche typologique, visant le classement des langues d’après plusieurs modèles ou types (de la structure syntaxique aux différents traits ou phénomènes linguistiques). Ce classement privilégie traditionnellement la coupe synchronique et se focalise d’abord sur ce qui différencie entre elles les langues naturelles ;
- une approche comparative, visant la comparaison entre langues d’une même famille ou de familles différentes, et ce non seulement en synchronie, mais également en diachronie. La comparaison, traditionnellement, vise à remonter, ou reconstituer, des langues ancestrales, ou « langues-mères ».
Cela dit, il est assez évident que pour classer des langues – c’est-à-dire les distribuer dans des ensembles typologiques – on ne peut faire en aucun cas l’économie de la comparaison.
Approches typologiques
Cette première partie du cours vise à fournir aux étudiants les informations de base concernant la typologie linguistique (désormais : TL). Loin d’être une discipline aux frontières bien délimitées, la TL sera envisagée dans toute sa complexité, que l’on pourrait définir comme un ensemble de tentatives, historiquement déterminées, de classer les langues d’après des critères (la « structure », d’abord et surtout, mais pas seulement) et suivant des questionnements divers. Notre approche sera donc à la fois synchronique et diachronique et, pour ce qui est de cette dernière, nous nous devrons de valoriser la composante idéologique qui a inspiré telle ou telle typologie linguistique à tel ou tel moment de l’histoire et dans tel ou tel contexte culturel, national. En effet, le classement des langues a souvent rimé avec leur hiérarchisation, qui, de fil en aiguille, a facilement débordé le cadre strictement linguistique pour atteindre et concerner la dimension culturelle, voire ethnique. Autrement dit, la TL a par le passé justifié, entre autres, un discours axiologique valorisant, ou dévalorisant, les langues en place et, par ricochet, les communautés porteuses de ces langues.
Par ailleurs, nous tâcherons de comparer la TL et le foisonnement lexical, terminologique et discursif qui s’y rattache, avec les formes, la terminologie et le discours typiques des classements relevant des sciences naturelles. On explorera ainsi, quoique de manière non systématique, les rapports et filiations qui lient les sciences du langage aux sciences naturelles. Dans cette perspective nous aborderons également le problème des universaux linguistiques (désormais : UL), sorte de chimère toujours recommencée des sciences du langage qui permettrait d’envisager celles-ci en tant que relevant, du moins en partie, des sciences naturelles. Si les UL ont pu être opposés aux TL, dans la mesure où les premiers se focalisent sur les ressemblances, les invariants du langage humain, alors que les secondes prennent en compte d’abord et surtout la diversité des langues, nous reconnaissons aujourd’hui la complémentarité foncière des études sur les UL et de celles sur les TL. Qui plus est, les UL nous poussant à prendre en compte moins les langues dans leur ensemble que quelques traits, phénomènes ou « types », nous serons amenés vers une sorte de déconstruction des TL. Il y a là un changement radical, voire un renversement de perspective : au lieu de chercher à classer les langues d’après des types idéaux, nous chercherons à cartographier dans quelles langues tel ou tel trait ou type est bien présent. C’est finalement le but principal du World Atlas of Language Structures, auquel nous ferons référence de manière assez systématique, notamment dans la seconde partie du cours.
Au cœur de cette vision complémentaire (UL et TL), il y a le sujet en tant qu’être de langage, doté d’un corps qui est à la fois physique (anthropologiquement déterminé), socio-linguistique (historiquement déterminé) et symbolique (anthropologiquement et historiquement déterminé). Pour chacun de ces « corps » on peut imaginer une particulière approche à la TL.
- Le corps physique renvoie aux contraintes organiques, particulièrement sensibles dans le cadre de l’acquisition des langues : celle-ci présente en effet des étapes universelles, anthropologiquement définies et peut-être en phase avec la règle de récapitulation ontophylogénique. Les étapes de l’acquisition des langues seraient dans ce cas-là un résumé du développement linguistique de l’espèce (phylogenèse).
- Le corps socio-linguistique renvoie à l’inscription historique du sujet dans un maillage social, sillonné en permanence par la langue et les interactions (en présence, en absence, en latence) qui façonnent son dire, de même que par les à-coups et les aléas de l’histoire : ces facteurs aboutissent, entre autres, à une typologie sociolinguistique des langues, classant les langues essentiellement d’après leurs fonctions et représentations partagées au sein des sociétés.
- Le corps symbolique renvoie quant à lui à la construction de la logosphère par rapport au point de vue du sujet enveloppé et en interaction permanente (à la fois physique, formelle, et socio-historique) avec l’environnement. Des phrases et syntagmes figés, dans les différentes langues-cultures, montrent bien la productivité sémantique de la représentation du corps dans l’espace (quelques exemples : représentation du temps par rapport à l’existence du sujet : « futur devant nous » versus « passé derrière nous », ou l’inverse ; abondance versus rareté de métaphores anthropomorphes ou zoomorphes ; particuliers systèmes de numération plus ou moins basés sur les arthrômes ; etc.) : une TL fondée sur la manière qu’ont les langues de « mettre à contribution » le corps symbolique paraît dès lors légitime.
Le point de vue du sujet contribue à problématiser, voire à court-circuiter, la TL.
Approches comparatives
La seconde partie du cours vise à sensibiliser les étudiants à la « multi-comparaison linguistique », à savoir la comparaison des langues (régionales, d’abord et surtout, de France et d’ailleurs) d’après plusieurs angles visuels et critères. La suite des travaux dirigés permettra en effet de sonder et questionner collectivement plusieurs formes de comparaison :
- Une comparaison « étique » (etic approach), c’est-à-dire strictement linguistique, objective (autant que possible). Quelques questions, en guise d’exemple : en quoi l’occitan s’éloigne-t-il du français (phonologie, syntaxe, lexique…) ? Est-ce que le rromani, diasporique en Europe, peut être considéré une langue unitaire malgré la forte variation diatopique ? Y a-t-il un critère discret, objectif, qui permette de rassembler plusieurs variétés linguistiques dans un même diasystème ? Le francoprovençal est-il un mélange de français et de provençal ? Peut-on parler, en termes scientifiquement fondés, de « distance » entre deux langues ? Et comment la mesurer ? Quelles sont les méthodes dialectométriques en usage ? Pourquoi les utilise-t-on ? Est-ce que le concept de « langue polynomique » peut être considéré comme une sorte de comparaison interne de variantes locales d’une même langue ? Quel est le rapport entre linguistique comparée, typologie linguistique et universaux linguistiques ? Et ainsi de suite.
- Une comparaison « émique » (emic approach), c’est-à-dire prenant en compte l’élément idéologique venant compliquer la donne linguistique étique : la comparaison bascule facilement dans la catégorisation, et la catégorisation peut déboucher sur la stigmatisation ou bien, à l’opposé, sur la survalorisation. D’autres questions, en guise d’exemple : le béarnais, c’est du gascon ? Le gascon, c’est de l’occitan ? Et le provençal, quant à lui, est-ce de l’occitan ? Y a-t-il continuité / interaction entre les concepts klossiens de « langue par élaboration » (ausbausprache), de « langue par distanciation » (abstandsprache) et de « langue-toit » (dachsprache) ? Quel rôle jouent les représentations sociales des langues dans leur catégorisation ? Quelle est la part d’idéologie qui permet de distinguer entre langue, dialecte, patois ? Et ainsi de suite.
- Une comparaison « évolutive », tenant compte de l’interaction des deux premières : comment se fait-il que l’occitan, langue de grand prestige littéraire en Europe occidentale au Moyen-Âge, soit perçu encore aujourd’hui, par une masse considérable de la population de France, comme un patois ? Quand est-ce que le corse, jadis considéré tout simplement comme de l’italien dialectal (usages populaires à l’oral), a émergé comme langue à part entière en même temps que langue écrite ? Quel est le rapport entre les variétés linguistiques diasporiques (na-našu, arbëresh) et les correspondantes langues de la mère patrie (croate, albanais) ? Et ainsi de suite.
Ecrire sur l'art et littérature et patrimoine
ECTS
6 crédits
Composante(s)
UFR Humanités
Période de l'année
Semestre 5
Littérature et patrimoine
ECTS
3 crédits
Composante(s)
UFR Humanités
Période de l'année
Semestre 5
Ecrire sur l'art
ECTS
3 crédits
Composante(s)
UFR Humanités
Période de l'année
Semestre 5
PRE-PROFESSIONNALISATION - PARCOURS : didactique du FLES
ECTS
6 crédits
Composante(s)
UFR Langues et Civilisations
Période de l'année
Semestre 5
Confrontation à l'apprentissage d'une langue nouvelle
Composante(s)
UFR Langues et Civilisations
Période de l'année
Semestre 5
Le cours de Confrontation à l’apprentissage d’une langue nouvelle vise une réflexion pratique sur le processus d’apprentissage d’une langue étrangère jamais étudiée auparavant. Il est constitué de 8h d'éléments théoriques et de 16h de cours de langue. Les étudiants auront le choix entre différentes langues, selon les critères suivants :
- la langue doit être nouvelle (non apprise auparavant) pour l'étudiant
- la langue peut être une langue étrangère "éloignée" du français (par exemple : arabe, basque, coréen, etc.) mais aussi une langue moins éloignée (par exemple l’occitan) pour voir quelles sont les stratégies d’apprentissage que l’apprenant met en place selon la langue qu’il apprend
- les cours doivent viser des objectifs de communication (pas de cours de description linguistique, pas de grammaire-traduction)
- les cours ne doivent pas être des cours particuliers.
Les cours de langue suivis feront l’objet d’une analyse qui s’appuiera sur les éléments théoriques délivrés pendant ces huit heures et qui viseront à articuler situation d’enseignement / apprentissage et facteurs et processus individuels d’apprentissage. Un “journal de bord” sera tenu par les étudiants tout au long du semestre.
Méthodologie du FLE 1 et analyse de manuels
Composante(s)
UFR Langues et Civilisations
Période de l'année
Semestre 5
Ce cours vise à présenter aux étudiants les méthodologies du Français Langue Étrangère et à leur permettre de se repérer dans l’offre éditoriale du champ du Français Langue Étrangère en tenant compte des types de public. Pour cela, le cours présente l’évolution historique de l’enseignement des langues étrangères et notamment du français comme langue étrangère. Il développe plus spécifiquement les principes méthodologiques du FLE depuis la méthodologie SGAV jusqu’à la perspective actionnelle, et donne des outils d’analyse des manuels afin de pouvoir les utiliser de façon pertinente en contexte professionnel.
Journalisme
ECTS
6 crédits
Composante(s)
UFR Humanités
Période de l'année
Semestre 5
Découverte du journalisme. Ses enjeux actuels et défis, ses métiers.
Télécharger le fichier «LicenceCHS.op.journalisme.IJBA.docx» (14.1 Ko)
Responsable pédagogique : Thais Barbosa De Almeira
Plurilinguisme et traduction
ECTS
6 crédits
Composante(s)
UFR Humanités
Période de l'année
Semestre 6
Théories du plurilinguisme
ECTS
3 crédits
Composante(s)
UFR Humanités
Période de l'année
Semestre 6
Poétique de la lecture : la poésie traduite
TD de Blanche TURCK, Eve DE DAMPIERRE-NOIRAY et Isabelle POULIN
Ce cours, qui rassemble en un même bloc de 4h hebdomadaires les deux enseignements phares de la licence Babel depuis la L1, Pratiques de la traduction et intermédialité, d’une part, et Théorie et plurilinguisme, d’autre part, propose de mêler une approche théorique et une approche pratique de la poésie traduite, afin d’aborder plusieurs aires linguistiques et culturelles : domaine russe (volet assuré par Isabelle Poulin), domaine hispanique - en particulier Argentine (volet assuré par Blanche Turck), domaine arabe - en particulier Mashrek et Palestine (volet assuré par Eve de Dampierre-Noiray).
Par poétique de la lecture, on entend l’idée que, face au texte poétique, le traducteur est avant tout un lecteur et qu’il élabore, par sa position et ses choix, une certaine lecture de la poésie, et donc une conception de la poésie. Traduire la poésie, c’est donc dire quelque chose de ce qu’est la poésie.
Cette réflexion s’appuiera sur une approche pratique, voire expérimentale, de textes poétiques traduits du russe, de l’espagnol, et de l’arabe, mais aussi sur une approche théorique (introduction aux approches critiques de la lecture développées depuis les années 1970 ; réflexion sur la pensée ou non pensée du plurilinguisme dans la théorie littéraire, histoire de la traduction, etc.). Pour les étudiants et étudiantes arrivés presque au terme de la licence Babel qui les a formés au plurilinguisme, il s’agira de prendre la mesure de la grande richesse et variété des pratiques de traduction, d’appréhender les évolutions propres à ces domaines linguistiques respectifs, mais aussi de comprendre combien nos démarches et manières de lire la poésie traduite (la mise en recueil, la constitution d’anthologies, par exemple) sont indissociables d’une pensée du genre poétique.
Le cours (2 x 2 h hebdomadaires, lundi 13h30-15h30 et mardi 10h30-12h30) prendra appui sur une anthologie fournie lors de la première séance. Les étudiants devront aussi se procurer l’ouvrage suivant :
Pratiques de la traduction et intermédialité
ECTS
3 crédits
Composante(s)
UFR Humanités
Période de l'année
Semestre 6
Poétique de la lecture : la poésie traduite
TD de Blanche TURCK, Eve DE DAMPIERRE-NOIRAY et Isabelle POULIN
Ce cours, qui rassemble en un même bloc de 4h hebdomadaires les deux enseignements phares de la licence Babel depuis la L1, Pratiques de la traduction et intermédialité, d’une part, et Théorie et plurilinguisme, d’autre part, propose de mêler une approche théorique et une approche pratique de la poésie traduite, afin d’aborder plusieurs aires linguistiques et culturelles : domaine russe (volet assuré par Isabelle Poulin), domaine hispanique - en particulier Argentine (volet assuré par Blanche Turck), domaine arabe - en particulier Mashrek et Palestine (volet assuré par Eve de Dampierre-Noiray).
Par poétique de la lecture, on entend l’idée que, face au texte poétique, le traducteur est avant tout un lecteur et qu’il élabore, par sa position et ses choix, une certaine lecture de la poésie, et donc une conception de la poésie. Traduire la poésie, c’est donc dire quelque chose de ce qu’est la poésie.
Cette réflexion s’appuiera sur une approche pratique, voire expérimentale, de textes poétiques traduits du russe, de l’espagnol, et de l’arabe, mais aussi sur une approche théorique (introduction aux approches critiques de la lecture développées depuis les années 1970 ; réflexion sur la pensée ou non pensée du plurilinguisme dans la théorie littéraire, histoire de la traduction, etc.). Pour les étudiants et étudiantes arrivés presque au terme de la licence Babel qui les a formés au plurilinguisme, il s’agira de prendre la mesure de la grande richesse et variété des pratiques de traduction, d’appréhender les évolutions propres à ces domaines linguistiques respectifs, mais aussi de comprendre combien nos démarches et manières de lire la poésie traduite (la mise en recueil, la constitution d’anthologies, par exemple) sont indissociables d’une pensée du genre poétique.
Le cours (2 x 2 h hebdomadaires, lundi 13h30-15h30 et mardi 10h30-12h30) prendra appui sur une anthologie fournie lors de la première séance. Les étudiants devront aussi se procurer l’ouvrage suivant :
Littérature
ECTS
6 crédits
Composante(s)
UFR Humanités
Période de l'année
Semestre 6
Littérature française et francophone
Composante(s)
UFR Humanités
Période de l'année
Semestre 6
Littérature française et francophone
Crises (du genre, du langage et du sujet) du 19è au 21è siècle
Description : Étude de deux ou trois œuvres du XIXe, XXe ou XXIe siècle.
Responsable de l’UE : Philippe ORTEL
Intervenants : Blandine Delanoy, Antoine Ducoux, Valéry Hugotte, Philippe Ortel.
Présentation de l’UE : Un cours magistral de 12h, assumé par Valéry Hugotte (6 h) et Alexandre Peraud (6 h) ; un TD de 36h pour chacun des groupes sauf pour la FAD (24h).
Programmes : chaque groupe a un programme différent
- Programme de Antoine Ducoux (TD 1).
Alfred JARRY, Ubu Roi, Paris, dossier par Françoise Spiess, Gallimard, coll. Folioplus Classiques, 2016 [toute édition est tolérée, mais celle-ci vous aidera grâce au dossier complémentaire]
Ahmadou KOUROUMA, Les Soleils des indépendances, Paris, Seuil, coll. « Points », 1970
Ce cours, qui privilégie l’analyse détaillée des textes et le commentaire composé, invite à l’exploration de deux œuvres peu étudiées mais fondamentales, qui ont marqué un tournant dans l’histoire théâtrale de la France métropolitaine et dans l’histoire du roman africain d’expression française : Ubu Roi, d’Alfred Jarry, et Les Soleils des indépendances d’Ahmadou Kourouma. Entre théâtre et roman, ce cours se centrera sur la notion de « crise » (du langage, de la représentation, de la mémoire et de l’identité). On envisagera la liaison d’une poétique théâtrale et romanesque avec un contexte politique trouble, marqué par une crise des valeurs, des institutions et des repères historiques et culturels. On situera également ces œuvres au sein d’un contexte artistique et éditorial plus large, pour en mesurer la singularité, au-delà des étiquettes conventionnelles dont le sens mérite d’être clarifié (théâtre de l’absurde, littérature postcoloniale…). On s’intéressera en particulier à l’usage que ces œuvres font du grotesque, garant d’une liberté inédite du style et des formes, pour proposer une satire du pouvoir, et comment cette dimension esthétique participe d’un renouvellement des formes dramatique et narrative. Aucune connaissance préalable sur les auteurs au programme n’est requise, mais la lecture des œuvres au programme avant le début des cours est indispensable.
- Programme de Blandine Delanoy (TD 2).
MUSSET, Lorenzaccio, Paris, GF Flammarion, 2012.
MALRAUX, La Condition humaine, Paris, Gallimard, coll. "Folio", 1972.
La pièce de Musset et le roman de Malraux ont pour point commun de faire d’une crise politique un élément clef de leur édifice fictionnel : en 1537, la ville de Florence se débat contre le régime tyrannique de Laurent de Médicis, tandis qu’un vent révolutionnaire souffle sur la Chine de 1937. Ces remous politiques, qui constituent des ressorts dramatiques puissants, mettent ainsi au jour diverses facettes de la notion de crise : crise existentielle chez des héros en quête d’eux-mêmes, crise du sens et de l’idéal politique au sein de communautés fragmentées, mal du siècle… sont autant soulevées par ces deux œuvres, entre renouveau et permanence des formes littéraires.
- Programme du groupe de M. Hugotte (TD 3, MEI) :
Comte de Lautréamont, Les Chants de Maldoror (Gallimard, «Poésie»)
Henri Michaux, Ailleurs (Gallimard, «Poésie»)
Bibliographie complémentaire
Bellour Raymond, Lire Michaux (Gallimard, « Tel », 2011).
Blanchot Maurice, Lautréamont et Sade (Editions de Minuit, « Arguments », 1949).
Hugotte Valéry, Lautréamont : Les Chants de Maldoror (P.U.F., « Etudes littéraires », 1999).
Michaux Henri, La Vie dans les plis (Poésie/Gallimard, 1990).
- Programme du groupe de M. Ortel (TD 4. Babel, Enseig./Recherc. et LC).
Maeterlinck, Intérieur dans Trois petits drames pour marionnettes, Espace-Nord, 2015 (ou toute autre édition).
Henri Michaux, Lointain intérieur dans Plume, précédé de Lointain intérieur, Poésie/Gallimard, 1963.
Ce cours s’organise autour de la notion de crise en littérature : crise dans la littérature (sa mise en scène) plutôt que crise de la littérature (ce qui est un autre sujet, bien que les deux questions puissent se rejoindre). Les deux œuvres au programme interrogent en profondeur notre perception habituelle de la réalité. Elles correspondent à deux époques différentes (XIXe/XXe siècles) et deux genres différents (théâtre et poésie). Ces deux œuvres sont à lire en relation avec le cours magistral.
Centré sur l’analyse des textes, ce cours privilégie l’explication linéaire (à titre d’exercice) et le commentaire composé (pour l’examen terminal). Il vise à approfondir vos connaissances s’agissant de la poétique de deux genres (théâtre et poésie), de deux grandes périodes de la littérature et à améliorer vos compétences en analyse des textes, organisation de vos idées et rédaction.
Littérature comparée
Composante(s)
UFR Humanités
Période de l'année
Semestre 6
Littérature comparée 1
Composante(s)
UFR Humanités
Période de l'année
Semestre 6
Le roman de la surveillance (TD de M. Engelibert)
On s’interrogera sur la mise en intrigue romanesque de la surveillance dans les sociétés contemporaines à partir de deux romans dystopiques : un des fondateurs du genre, 1984 de George Orwell (1949), et un contemporain, Les Furtifs d’Alain Damasio (2019). Ces romans décrivent des sociétés où une pratique généralisée de la surveillance accompagne un recul du droit et on y voit couramment une critique des systèmes de discipline ou de contrôle qu’ont connu leurs auteurs. Mais on peut aussi y lire, ancrée dans l’histoire longue de la littérature utopique, une mise en fiction de dispositifs de visibilité, posant les questions de l’asymétrie du regard (qui voit ? qui est vu ?), des rapports de pouvoir et de la subjectivation. C’est à partir de l’analyse des procédés de la fiction (voix narratives et points de vue, espace-temps diégétique, caractérisation des personnages, etc.) que se détachera la politique de ces romans, c’est-à-dire la manière dont ils représentent et donnent à éprouver le monde commun.
Littérature comparée 2
Composante(s)
UFR Humanités
Période de l'année
Semestre 6
Littérature comparée 3
Composante(s)
UFR Humanités
Période de l'année
Semestre 6
Anglais
ECTS
3 crédits
Composante(s)
UFR Humanités
Période de l'année
Semestre 6
Le cours se déroulera en 2 parties
- Semaines 1 à 6 : TD de Lucy Edwards, vendredi 10h30-12h30
Séances les 27 janvier, 3, 10 et 24 février, 3 et 10 mars 2023
This course will centre mainly on improving students' oral skills, with a view to boosting confidence and authenticity of expression in the fields of debating, discussion, interaction and presentation techniques. Activities will explore the theme of 'the beaten track' and how we
aspire to stick to it or stray away.
- Semaines 7 à 12 : TD de Véronique Béghain, mardi 13h30-15h30
Séances les 14, 21 et 28 mars, 4, 11 et 25 avril
Approche de la traduction littéraire :
Il s’agit d’un cours d’entraînement à la pratique de la traduction littéraire anglais-français à partir d’extraits d’œuvres longues ou de courtes nouvelles, issues du domaine anglophone. Nous travaillerons également les deux langues et le passage de l’une à l’autre à partir d’exercices de comparaison de traductions publiées d’œuvres du domaine anglophone.
Langues et cultures du monde
ECTS
9 crédits
Composante(s)
UFR Humanités
Période de l'année
Semestre 6
Cette UE comprend 3 cours :
- Langue 2, TD, 24h ou 36h, Liste à choix (langues du CLBM : poursuite de la langue 2)
Modalités de validation :
Session 1 : contrôle continu
Session 2 : oral 20 min
- Bouquet culturel, 24 h (mutualisé LLCE)
Liste à choix :
Etudes slaves : Civilisation des pays slaves 24h TD. Pas de prérequis linguistique.
Arabe : Civilisation du monde arabe contemporain 24h CM. Pas de prérequis linguistique.
Italien : Arts et littérature 24hTD. Prérequis en langue italienne : B1
Allemand : Art et cinéma allemands. Prérequis en langue allemande : B1
Portugais : Cultures croisées des pays lusophones. Prérequis en langue portugaise : A2-B1
Pour les descriptifs de ces cours, voir Infos complémentaires plus bas.
- Langue 3 (poursuite du choix fait en L1-L2)
Choix 1 : Langue vivante 3 (mutualisé CLBM > liste à choix des langues CLBM)
Modalités de validation :
Session 1 : contrôle continu
Session 2 : oral 20 min
Choix 2 : Latin (mutualisé LM) 24h
Modalités de validation :
Session 1 : contrôle continu
Session 2 : oral 15 min (30 min de préparation + 15 min de passage)
Choix 3 : Langue française : stylistique du français moderne (mutualisé LM) 24-36h
Enseignante : Vanessa Oberliessen
NB : le cours a lieu le lundi de 13h30 à 15h30 + le mardi de 13h30 à 15h30 par quinzaine, à partir de la semaine du 24 janvier.
Vous manquerez 3 séances à cause du cours d’anglais de Mme Béghain, en mars. Mais Mme Oberliessen vous donnera le matériel pour travailler sur Ecampus.
NB : les étudiants qui prennent le bouquet culturel Civilisation du monde arabe contemporain et ont choisi au S5 « Français moderne » iront dans le cours de Stylistique de L2 (licence Lettres modernes) :
Enseignante : Françoise Poulet
TD n°2 (jeudi 10h30-12h30) ou TD n°3 (vendredi 13h30-15h30)
Le cours est consacré à la prosodie de la poésie française des XVIIe-XVIIIe siècles (versification, métrique, API...) et à la stylistique du français de cette époque.
Le cours ne s’affichera pas dans votre EDT donc pensez à bien demander les salles à Céline Barral par email au début du semestre.
Langue 2
ECTS
3 crédits
Composante(s)
UFR Humanités
Période de l'année
Semestre 6
Italien S6
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 6
Italien débutant A1 semestre 6
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 6
Italien consolidation A2 semestre 6
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 6
Italien intermédiaire B1 semestre 6
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 6
Italien expert C1 semestre 6
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 6
Italien avancé B2 semestre 6
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 6
Russe S6
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 6
Russe avancé B2 semestre 6
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 6
Russe intermédiaire B1 semestre 6
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 6
Russe consolidation A2 semestre 6
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 6
Russe débutant A1 semestre 6
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 6
Arabe S6
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 6
Arabe intermédiaire B1 semestre 6
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 6
Arabe avancé B2 semestre 6
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 6
Arabe débutant A1 semestre 6
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 6
Arabe consolidation A2 semestre 6
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 6
Polonais S6
Composante(s)
UFR Langues et Civilisations
Période de l'année
Semestre 6
Langue polonaise : initiation ou consolidation.
Espagnol S6
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 6
Espagnol expert C1 semestre 6
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 6
Espagnol débutant A1 semestre 6
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 6
Espagnol consolidation A2 semestre 6
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 6
Espagnol intermédiaire B1 semestre 6
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 6
Espagnol avancé B2 semestre 6
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 6
Grec moderne S6
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 6
Grec moderne débutant A1 semestre 6
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 6
Grec moderne intermédiaire B1 semestre 6
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 6
Grec moderne consolidation A2 semestre 6
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 6
Grec moderne avancé B2 semestre 6
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 6
Communiquer en portugais 6
Composante(s)
UFR Langues et Civilisations
Période de l'année
Semestre 6
Il s’agira de mettre l’accent sur des activités amenant l’étudiant à produire des textes complexes, argumentatifs et s’exprimer aisément sur des sujets de plus en plus variés.
Allemand S6
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 6
Allemand avancé B2 semestre 6
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 6
Allemand intermédiaire B1 semestre 6
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 6
Allemand débutant A1 semestre 6
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 6
Allemand expert C1 semestre 6
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 6
Allemand consolidation A2 semestre 6
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 6
Cultures du monde
ECTS
3 crédits
Composante(s)
UFR Humanités
Période de l'année
Semestre 6
Histoire et civilisations arabes
ECTS
3 crédits
Composante(s)
UFR Langues et Civilisations
Période de l'année
Semestre 6
Cultures croisées des pays de langue portugaise 4
Composante(s)
UFR Langues et Civilisations
Période de l'année
Semestre 6
Il s'agira de mettre en relation les cultures des pays lusophones à partir de la question de la subalternité.
Culture et société des pays slaves
Composante(s)
UFR Langues et Civilisations
Période de l'année
Semestre 6
Étude approfondie des civilisations des pays slaves.
Arts et cinéma
Composante(s)
UFR Langues et Civilisations
Période de l'année
Semestre 6
Lecture et analyse d’œuvres cinématographiques en langue allemande.
Cultures du Japon 4
ECTS
3 crédits
Composante(s)
UFR Langues et Civilisations
Période de l'année
Semestre 4
Cours neutralisé pour l'année 2022-2023
Langue 3
ECTS
3 crédits
Composante(s)
UFR Humanités
Période de l'année
Semestre 6
Serbo-croate S6
ECTS
3 crédits
Composante(s)
UFR Langues et Civilisations
Période de l'année
Semestre 6
Langue serbo-croate : initiation ou consolidation.
Basque S6
ECTS
3 crédits
Composante(s)
Scolarité
Période de l'année
Semestre 6
Italien S6
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 6
Italien débutant A1 semestre 6
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 6
Italien consolidation A2 semestre 6
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 6
Italien intermédiaire B1 semestre 6
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 6
Italien expert C1 semestre 6
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 6
Italien avancé B2 semestre 6
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 6
Japonais S6
ECTS
3 crédits
Composante(s)
Scolarité
Période de l'année
Semestre 6
Langues des signes S6
ECTS
3 crédits
Composante(s)
Scolarité
Période de l'année
Semestre 6
6LDRM511 Programme 1 Langue et culture latines
Composante(s)
UFR Humanités
Période de l'année
Semestre 6
- Langue et culture latines -
(cliquez sur le - bouton rouge - pour télécharger le descriptif du programme de l’année universitaire 2022-2023).
La femme dans le monde romain
Intervenante : Anne Bajard
Russe S6
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 6
Russe avancé B2 semestre 6
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 6
Russe intermédiaire B1 semestre 6
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 6
Russe consolidation A2 semestre 6
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 6
Russe débutant A1 semestre 6
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 6
Vietnamien S6
ECTS
3 crédits
Composante(s)
Scolarité
Période de l'année
Semestre 6
Suédois S6
ECTS
3 crédits
Composante(s)
Scolarité
Période de l'année
Semestre 6
Arabe S6
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 6
Arabe intermédiaire B1 semestre 6
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 6
Arabe avancé B2 semestre 6
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 6
Arabe débutant A1 semestre 6
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 6
Arabe consolidation A2 semestre 6
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 6
Persan S6
ECTS
3 crédits
Composante(s)
Scolarité
Période de l'année
Semestre 6
Polonais S6
Composante(s)
UFR Langues et Civilisations
Période de l'année
Semestre 6
Langue polonaise : initiation ou consolidation.
Tchèque S6
ECTS
3 crédits
Composante(s)
UFR Langues et Civilisations
Période de l'année
Semestre 6
Langue tchèque : initiation ou consolidation.
Turc S6
ECTS
3 crédits
Composante(s)
Scolarité
Période de l'année
Semestre 6
Espagnol S6
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 6
Espagnol expert C1 semestre 6
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 6
Espagnol débutant A1 semestre 6
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 6
Espagnol consolidation A2 semestre 6
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 6
Espagnol intermédiaire B1 semestre 6
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 6
Espagnol avancé B2 semestre 6
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 6
Catalan S6
ECTS
3 crédits
Composante(s)
Scolarité
Période de l'année
Semestre 6
Coréen S6
ECTS
3 crédits
Composante(s)
Scolarité
Période de l'année
Semestre 6
Grec moderne S6
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 6
Grec moderne débutant A1 semestre 6
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 6
Grec moderne intermédiaire B1 semestre 6
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 6
Grec moderne consolidation A2 semestre 6
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 6
Grec moderne avancé B2 semestre 6
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 6
Occitan S6
Composante(s)
UFR Langues et Civilisations
Période de l'année
Semestre 6
Roumain S6
ECTS
3 crédits
Composante(s)
Scolarité
Période de l'année
Semestre 6
Allemand S6
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 6
Allemand avancé B2 semestre 6
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 6
Allemand intermédiaire B1 semestre 6
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 6
Allemand débutant A1 semestre 6
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 6
Allemand expert C1 semestre 6
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 6
Allemand consolidation A2 semestre 6
Composante(s)
CLEFF - Cité des langues
Période de l'année
Semestre 6
Chinois S6
ECTS
3 crédits
Composante(s)
Scolarité
Période de l'année
Semestre 6
Spécialisation
ECTS
6 crédits
Composante(s)
UFR Humanités
Période de l'année
Semestre 6
Liste à choix :
- Didactique du FLE, 36h, Mutualisé SDL
DIDACTIQUE DU FLE – Semestre 2 : 2 cours
Méthodologie du FLE et élaboration de matériel pédagogique
Le cours s’organise autour de deux volets. Dans un premier temps, sera menée une réflexion sur la / les progression(s) d’apprentissage à partir des descripteurs du CECRL et de leur application dans quelques manuels actuels. Dans un deuxième temps, on travaillera sur la planification et l'élaboration d'activités pédagogiques à partir de différents supports écrits et oraux.
Modalités de validation :
Session 1 : contrôle terminal : rapport/dossier (1 semaine), sans soutenance
Session 2 : rapport/dossier (1 semaine), sans soutenance
Apprentissages et activités interculturels
Ce cours vise à développer la compétence interculturelle des étudiants, par l’acquisition d’outils conceptuels propres à appuyer une démarche interculturelle, et à prendre conscience des enjeux interculturels dans l’enseignement / apprentissage d’une langue étrangère. En prenant connaissance de ce champ d’études et de pratiques spécifiques, l’étudiant sera en mesure de proposer des activités interculturelles aux apprenants de FLE, et de prendre en compte la dimension interculturelle dans la gestion des activités d’apprentissage.
Modalités de validation :
Session 1 : contrôle terminal : rapport/dossier (1 semaine), sans soutenance
Session 2 : rapport/dossier (1 semaine), sans soutenance
- Linguistique, 48h, Mutualisé SDL
LINGUISTIQUE GENERALE – Semestre 2. 2 cours :
Linguistique et sciences connexes
Une partie du cours portera sur les sciences du langage au sens très large, à travers les grandes questions que pose l’étude des langues naturelles, et qui ont été soulevées par la philosophie, l’histoire, la sociologie, l’anthropologie, la psychologie, les neurosciences, voire l’informatique et les sciences de la communication. Une autre partie du cours portera plus spécifiquement sur les fondements de la linguistique moderne comme une science à part entière, à travers des linguistes comme Saussure, Jakobson ou encore Chomsky, en montrant là encore l’apport des sciences connexes dans la recherche actuelle en linguistique.
Modalités de validation :
Session 1 : contrôle continu
Session 2 : oral 20 min
Approche typologique des langues : domaine japonais
Ce cours a pour objectif de présenter la langue japonaise dans ses différentes facettes (origines, histoire, écriture, phonologie, morphologie, syntaxe, pragmatique, etc.) à partir d'un point de vue typologique que l'on peut résumer par la question générale suivante : comment le japonais se situe-t-il par rapport aux autres langues du monde ?
Modalités de validation :
Session 1 : contrôle continu
Session 2 : oral 20 min
- Journalisme / écriture, mutualisé CHS et MEI
(au S6 : Ecrire sur l’art + Transferts, adaptations, réécritures, mutualisés MEI)
Ecrire sur l’art (cours d’Anne-Laure Metzger) 6LDMU511 24hTD
Le cours a pour objectifs l’étude et la production de textes critiques sur l’art, à partir d’analyses de textes et d’œuvres, dont certaines en situation si possible (expositions, visites au MAAD et au Musée des Beaux Arts) .
La partie théorique du cours portera essentiellement sur la critique picturale des œuvres de la Renaissance au XVIIIe siècle, produite du XVI e au XXe siècles. L’autre partie, pratique, consistera en un atelier d’écriture visant à développer les compétences rédactionnelles des étudiants.
Bibliographie :
Denis Diderot, Salons (plus particulièrement les textes sur Chardin, Greuze, Boucher, Van Loo, tirés des Salons de 1763 et 1765), Gallimard, « Folio classiques » n°4707 l’achat de cet ouvrage est facultatif.
Daniel Arasse, On n’y voit rien, Gallimard, « Folio Essai » n° 417, 2004. A acheter.
Transferts, adaptations, réécritures (6LDMU522) : cours de M. Chatti)
Transferts, adaptations, réécritures littéraires :
Quelques exemples (littérature, cinéma, ateliers d’écriture)
Ce cours interroge les modalités de transposition d’un medium à un autre, ainsi que les mécanismes des pratiques scripturales (réécritures littéraires / ateliers d’écriture). Le « passage du langage littéraire au langage cinématographique permet à l’œuvre adaptée de toucher un public beaucoup plus vaste que l’œuvre originale du fait du média lui-même ». En effet, le cinéma est « le mode de réception privilégié de notre époque » où le visuel occupe un rôle prépondérant (in Caroline Fischer, Intermédialités, SFLGC/Lucie édition, 2015). Est-ce qu’une œuvre littéraire (roman, théâtre, conte) est traduisible dans une œuvre relevant d’un autre art ? Quelles relations s’établissent alors entre des œuvres issues d’arts différents ? Par ailleurs, ce cours se conçoit comme une incitation à écrire puisqu’une pratique régulière de l’écriture donnera une compréhension interne des fonctionnements textuels qu’on ne pourrait acquérir par la seule analyse théorique.
Corpus (à lire / à voir x 6 œuvres au choix) :
Molière, Dom Juan (théâtre, 1665)
Marcel Bluwal, Dom Juan ou le Festin de Pierre (film, 1965)
Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac (théâtre, 1897)
Jean-Paul Rappeneau, Cyrano de Bergerac (film, 1990)
Choderlos de Laclos, Les Liaisons dangereuses (roman, 1782)
Roger Vadim, Les Liaisons dangereuses (film, 1959)
Octave Mirbeau, Le Journal d’une femme de chambre (roman, 1900)
Luis Buñuel, Le Journal d’une femme de chambre (film, 1964)
Les Mille et une nuits (contes)
Pier Paolo Pasolini, Les mille et une nuits (film, 1974)
Bibliographie (indicative) :
Caroline Fischer (dir.), Intermédialités, Paris, SFLGC/Lucie édition, 2015.
Gaëlle Loisel et Fanny Platelle, Traduction et Transmédialité (XIXe-XXIe siècles), Paris, Classiques Garnier, 2021.
Marguerite Perdriault, L’écriture créative, Toulouse, Érès, 2014.
Anne Roche, Andrée Guiguet et Nicole Voltz, L’atelier d’écriture. Éléments pour la rédaction du texte littéraire (2005), Paris, Armand Colin, « Cursus », 2015.
Sitographie :
https://litteraturefrancaise.net/fr/
Évaluation :
1ère session :
Régime général : Contrôle continu.
Dispensés : voir MECC.
2e session : voir MECC.
- Spécialisation littéraire, mutualisé LM
- liste à choix, 2 cours parmi Littérature et culture 2, Littérature et culture 3, Littérature et culture 4, Approfondissement recherche littérature comparée
Littérature et culture 2 (Littérature de jeunesse)
Littérature et culture 3 (Texte et représentation théâtrale)
Littérature et culture 4 (Texte et image)
Approfondissement recherche en littérature comparée
Descriptifs
- Littérature et culture 2 / Littérature de jeunesse (6LDRE513) : cours de Myriam Tsimbidi
Le voyage dans la littérature de jeunesse
Ce cours présentera dans un premier temps une histoire de la littérature de voyage pour la jeunesse et posera les invariants du genre, fondements indispensables pour apprécier les œuvres contemporaines. Ces dernières offrent une multitude de choix formels et génériques : récits mythique, documentaire, romanesque, autobiographique ; relation de voyage sous forme de journal, de carnet illustré, ou encore de correspondance. Le cours portera notamment sur œuvres qui donnent à voir le voyage qui sera défini afin d’étudier l’éloquence de l’image et le spectacle du texte, ainsi que les phénomènes de pastiches et d’intericonicité.
L’analyse repose sur des savoirs d’histoire de la littérature, des compétences d’analyse sémiotique, stylistique et rhétorique, et nécessite de connaître au moins quatre des œuvres traitées en cours.
Evaluation : Une présentation orale d’un extrait d’ouvrage ; un devoir écrit portant sur l’ensemble du cours.
Le corpus distribué en classe sera composé notamment d’extraits des ouvrages suivants :
BOTTERO Pierre, La quête d’Ewilan, Livre de poche, 2003.
CONNOLLY John, Le livre des choses perdues, J’ai Lu, 2009.
DASHNER, Le Labyrinthe, Pocket jeunesse, 2012.
L’Auberge de nulle part, J. Patrick LEWIS, ill. Roberto INNOCENTI, trad. Anne Krief, éd. Gallimard Jeunesse, 2000.
La Fabuleuse découverte des îles du dragon, SCARBOROUGH Kate, ill. Martin MANIEZ, trad. Valérie Julia, Hatier, 2007.
MIAO Sang, Un voyage sans fin, trad. Shaine Cassim, De la Martinière jeunesse, 2019.
PLACE François, Les derniers géants, Paris , Casterman, 1992 (nombreuses rééditions).
PONTI Claude, L’arbre sans fin, L’École des Loisirs, 1992.
PULLMAN Philip, À la croisée des mondes, 3 t., Gallimard, 1998.
SIS Peter, Christophe Colomb, Grasset Jeunesse, 1996.
SIS Peter, Les trois clés d’or de Prague, Grasset Jeunesse, 1995.
Bibliographie succincte qui sera complétée à la rentrée
Béhotéguy Gilles, « Quête à la carte et visites guidées de quelques mondes imaginaires.. » dans Cartes et Plans : paysages à construire, espace à Rêver, Cahiers robinson, n°28, 2010, P91-101.
Besson Anne « L’imaginaire cartographique dans la Fantasy pour la jeunesse » Cartes et Plans : paysages à construire, espace à Rêver, Cahiers robinson, n°28, 2010, p. 105-116.
Déom Laurent, « Le roman initiatique : éléments d’analyse sémiologique et symbolique », dans Cahiers électroniques de l’imaginaire, n° 3 : Rite et littérature, 2005, p. 73-86.
Garnier Xavier, « A quoi reconnaît-on un récit initiatique ? », Poétique 2004/4, p. 443-454.
Van der Linden Sophie, Lire l’album, Atelier du Poisson soluble, 2006.
Vierne Simone, Rite, roman, initiation (1973), deuxième édition revue et augmentée, Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, 1987.
Modalités de validation :
Session 1 : contrôle continu
Session 2 : oral (préparation 30 min, oral 15 min. Exposé + entretien)
- Littérature et culture 3 /Texte et représentation théâtrale (6LDRE514): cours de Mounira Chatti
Tragédie et enquête : mythe et histoire
Le dramaturge et metteur en scène libano-canadien Wajdi Mouawad explique ainsi sa « collision » avec Sophocle dont il a mis en scène l’intégrale des tragédies : « Au départ un artiste devient un artiste parce qu’il rencontre un autre artiste. Cette collision pour moi est vraiment fondamentale. Chez moi elle s’est passée, entre autres, à travers Sophocle : c’est-à-dire l’envie de faire comme lui, l’envie d’écrire moi aussi une tragédie, l’envie de bouleverser comme j’ai été bouleversé, l’envie d’appartenir à ça » (2012). Souvent qualifiée d'épique, Incendies « fait de la guerre le théâtre du théâtre où le corps déserté, la vie disparue fondent la nécessité d'un départ, d'un périple, d'une Odyssée. Après le cataclysme de la guerre, le théâtre, comme surgissement, devient le lieu de libération de la parole et de restauration des images en lien avec le pays perdu. L’écriture permet de tenter de comprendre le sens de la guerre et de revenir sur l’Histoire en remontant vers la génération précédente, celle des parents qui ont choisi l’exil » (F. Coissard). Par ailleurs, bien que l’intrigue d’Incendies « s’écarte de celle d’Œdipe, elle emprunte plusieurs motifs au mythe : naissance maudite, condamnation et sauvetage clandestin des nourrissons, intervention providentielle d’un berger, enfance et jeunesse loin des parents biologiques, inceste du fils et de la mère, reconnaissance tardive de l’enfant perdu. Et le motif central de l’aveuglement, comme métaphore de la démesure, signe de la tragédie, est commun aux deux pièces. Surtout, Mouawad reprend à Sophocle une construction singulière, celle de l’enquête sur les faits passés, où l’horreur ne s’accomplit pas sous nos yeux, au présent : c’est à l’histoire de sa révélation que nous assistons. Le présent n’est pas celui des crimes mais de leur récit » (Sandrine Montin).
Textes de référence : lectures obligatoires
Sophocle, Œdipe roi
Wajdi Mouawad, Incendies (2003/2009), Actes Sud, coll. « Babel Littérature », 2011.
Bibliographie (indicative)
Aristote, Poétique
Jacqueline de Romilly, La tragédie grecque, Quadrige, 1997.
Christine Dubarry, Étude sur Œdipe roi (1994), Ellipses, 2005.
Françoise Coissard, Wajdi Mouawad : Incendies, Champion, 2014.
Sylvain Diaz, Avec Wajdi Mouawad, tout est écriture, Actes Sud, 2017.
Galbert Davez Lebita, Forme et sens dans la tétralogie de Wajdi Mouawad : lecture de la transmission de la mémoire, thèse de doctorat, 2016, en ligne.
Sandrine Montin, « Incendies de Wajdi Mouawad : une réécriture d’Œdipe roi », en ligne.
D’autres références bibliographiques seront précisées pendant le cours.
Modalités de validation :
Session 1 : contrôle continu
Session 2 : oral (préparation 30 min, oral 15 min. Exposé + entretien)
- Littérature et culture 4 /Transferts culturels6LDRE515 :
Enseignante : Vérane Partensky
Programme : Usages de l’Antiquité grecque autour de 1900
« Qui nous délivrera des Grecs et des Romains ? » L’alexandrin proverbial de Berchoux, que Baudelaire reprend à son compte, formule comiquement la sclérose scolaire qui atteint l’héritage antique à l’aube du romantisme. Que faire de l’antiquité ? Au moment où la révolution romantique récuse les normes de l’esthétique classique et appelle de ses vœux la modernité, le devenir et l’usage de l’antiquité apparaissent comme problématiques. Cependant, loin d’être simplement reléguée du côté des choses désuètes, l’antiquité fait l’objet, tout au long du XIXe siècle, d’une série de réévaluations qui infléchissent son sens, au point de cristalliser, au tournant des XIXe et XXe siècle, les valeurs des avant-gardes esthétiques. On verra ainsi que l’antiquité grecque est, non une réalité objective, mais une construction littéraire et culturelle qui subit des variations remarquables selon le contexte de sa réception. On interrogera l’usage et la fonction de la référence à la Grèce antique et leurs variations en Europe (Allemagne, Autriche, France, Angleterre) entre la période romantique et le début du XXème siècle, en privilégiant la période 1900 : on envisagera notamment le mythe de la sérénité grecque, le rêve archéologique du XIXe siècle, la dialectique de l’apollinien et du dionysiaque, et la question de la libération du corps dans une perspective d’anthropologie culturelle.
Outre les œuvres du corpus, le cours s’appuiera sur une anthologie de textes courts et d’extraits ainsi que sur des œuvres plastiques et architecturales (peinture, sculpture, architecture), opératiques (Offenbach, La Belle Hélène, Strauss, Elektra) ; on abordera également le renouvellement de la danse (Nijinski, Isadora Duncan, Émile Jaques-Dalcroze).
Corpus (lectures obligatoires. Les œuvres en gras sont à acheter) :
- T. A. von Hofmannsthal, « Instants de Grèce » (trad. Jean-Claude Schneider), in Lettre de Lord Chandos et autres textes, Paris, Poésie/Gallimard, 1992
Thomas Mann, La Mort à Venise, (trad. Philippe Bertaux et Charles Sigwalt) in La Mort à Venise Suivi de Tristan et de le Chemin du cimetière, Livre de poche. (ISBN : 2253006459)
Walter Pater, « Denys l’auxerrois » et « Le Duc Carl de Rosenmold », in Portraits imaginaires, trad. Philippe Neel, Éditions Ombres (ISBN : 2070327191)
Stéphane Mallarmé, « L’après-midi d’un faune » (texte fourni par l’enseignante).
Des textes photocopiés et des diaporamas (en ligne sur e-campus) complèteront ce corpus.
Choix de lectures complémentaires :
Charles Baudelaire, « L’école païenne », in L’art romantique (nombreuses éditions possibles).
André Gide, Corydon, Paris, Gallimard, coll. Folio (notamment les dialogues 3 et 4).
Pierre Louÿs, Les Chansons de Bilitis, Paris, Poésie/Gallimard
Friedrich Nietzsche, La Naissance de la tragédie, Trad. de l'allemand par Michel Haar, Philippe Lacoue-Labarthe et Jean-Luc Nancy, Paris, Gallimard, coll.Folio Essais n° 32 (ISBN 9782070325429)
Walter Pater, « Winckelmann » in La Renaissance, Paris, Classique Garnier 2016 (trad. Bénédicte Coste) ou Paris, Payot, 1917 (trad. Philippe Neel).
- Schiller, De LaPoésie naïve et sentimentale, trad. Sylvain Fort, L'Arche éditions.
John Addington Symonds, « The Genius of Greek Art », Studies of the Greek poets, 1873, rééditions augmentées en 1879 et 1893. Consultable en ligne sur archiv.org (attention, à partir de l’édition remaniée de 1893, le chapitre est déplacé dans le 2e volume (et devient chapitre 24).
Modalités de validation :
Session 1 : contrôle continu
Session 2 : oral (préparation 30 min, oral 15 min. Exposé + entretien) Important : à l’examen, les étudiants doivent impérativement apporter les œuvres au programme.
- Approfondissement recherche en littérature comparée 6LDRU4: 18/36hTD
Enseignantes : Céline Barral et Ève de Dampierre-Noiray
Lundi 15h30-17h30 (E. de Dampierre) : 9 séances et/ou mardi 15h30-17h30 (C. Barral : 9 séances)
Scénographie de l’écrivain dans la littérature mondiale.
Comment penser la figure et fonction de l’écrivain, de l’auteur et du poète dans les littératures extra-européennes ?
Ce cours propose d’initier les étudiants parvenus au 6e semestre de leur licence de Lettres modernes ou Lettres et langues (Babel) à la pratique de la recherche dans le domaine de la littérature comparée. Leur familiarité avec cette matière, présente dans leur cursus chaque semestre depuis la L1, servira de cadre à l’apprentissage et l’expérimentation de nouvelles démarches et méthodes de travail, qui sont celles des chercheurs et des chercheuses. Dans ce cours conçu et pris en charge à deux enseignantes-chercheuses comparatistes, nous proposons une réflexion sur la figure de l’écrivain et la fonction de l’auteur dans les littératures extra-européennes, en particulier dans deux aires culturelles et linguistiques : l’aire asiatique (volet assuré par Céline Barral) et le monde arabo-musulman (volet assuré par Eve de Dampierre-Noiray).
Il s’agira donc :
- d’articuler un corpus de textes littéraires avec un corpus de textes théoriques consacrés à la figure de l’écrivain (de l’auteur, du poète, etc.) pour comprendre quelle place et quel statut lui accordent ces aires culturelles et linguistiques respectives
- de réfléchir à ces enjeux dans une approche comparée des littératures et théories critiques qui sont les nôtres (souvent européo-centrées, la plupart du temps même produites en France et en français) avec des littératures et conception théoriques très éloignées, à la fois des nôtres et entre elles.
- d’aborder ce corpus aux dimensions géographiques vastes à travers un petit nombre de problématiques transversales (l’écrivain dans la littérature mondiale et le rapport entre centre et périphérie ; le rôle politique de l’écrivain et la question de l’écrivain national ; le rapport entre poésie et exil, etc.), même si nous aborderons aussi des questions propres à chacune des deux cultures, sans forcer la réciprocité de la réflexion.
Proposée au terme de la licence, cette ouverture à la recherche en littérature comparée s’appuie sur un ensemble de connaissances comem de pratiques de lecture et d’analyses acquises tout au long de votre formation en lettres, et est particulièrement approprié pour les étudiants qui veulent se lancer dans un master (REEL ou autres, à l’UBM, ou dans d’autres universités), et sont désireux de choisir un sujet ou domaine de recherches comparatiste.
- Corpus
Le cours prendra appui sur une anthologie de textes extraits de la littérature (roman, poésie, récit autobiographique) et d’essais critiques appartenant à chacune de ces aires. En plus de la lecture approfondie de ces extraits, il est demandé à chaque étudiant la lecture d’une œuvre intégrale au minimum, parmi les œuvres d’où sont tirés les extraits :
Séances du lundi (Eve de Dampierre-Noiray) / monde arabo-musulman :
Chawqî BAGHDÂDÎ, « Sauf moi » dans On te demande comment va Damas, trad. de l’arabe (Syrie) par Claude Krul, Alidades, 2017.
Heidi TOELLE, présentation du volume Les Suspendues (Al-Mu‘allaqât), trad. de l’arabe par H. Toelle, Flammarion, 2009.
- W. SAID, A contre-voie, mémoires (Out of place, 1999), trad. de l’anglais par Brigitte Caland et Isabelle Genet, Le Serpent à plumes, 2002.
Alaa EL ASWANY, J’aurais voulu être Egyptien (Nirân Sadîqa), préface, trad. de l’arabe (Egypte) par Gilles Gauthier, Actes sud, 2009.
Albert MEMMI, Portrait du colonisé (1957), Gallimard, Folio essais, 1985.
Taha HUSSEIN, Le livre des jours (Al-Ayyâm I et II, 1939), trad. de l’arabe (Egypte) par Jean Lecerf (partie 1) et Gaston Wiet (partie 2), Gallimard, 1947.
Taha HUSSEIN, La traversée intérieure (Al-Ayyâm, III, 1955), trad. de l’arabe (Egypte) par Guy Rocheblave Gallimard, 1992.
Mohamed KACIMI, L’Orient après l’amour, Actes sud, 2008.
Mahmoud DARWICH, La Palestine comme métaphore, entretiens traduits de l’arabe (Palestine) par Elis Sanbar et de l’hébreu par Simone Bitton, Actes sud, 1997.
Iman MERSAL, « J’ai un nom musical » (1995) dans Des choses m’ont échappé, anthologie poétique traduite de l’arabe (Egypte) par Richard Jacquemond, Actes sud, 2018.
Iman MERSAL, Sur les traces d’Enayyat Zayyat (Fi athar ‘Inayyat az-zayyât, 2019), traduit de l’arabe (Egypte) par Richard Jacquemond, Actes sud, 2021.
Richard JACQUEMOND, Entre scribes et écrivains, Le champ littéraire
Eve DE DAMPIERRE-NOIRAY, De l’Egypte à la fiction, récits arabes et européens du XXe siècle, Classiques Garnier, 2014
Eve DE DAMPIERRE-NOIRAY, « Fiction and the Arab islamic world dans Fiction and Belief », article à paraître en 2023.
Randa SABRY, Voyager d’Egypte et inversement
Séances du mardi (Céline Barral) / aire asiatique :
Wu Jingzi, Chronique indiscrète des mandarins (milieu XVIIIe), tr. Tchang Fou-jouei, Gallimard/UNESCO, coll. Connaissance de l’Orient, 1976
Kouo Mo-jo (Guo Moruo), Autobiographie. Mes années d’enfance (1947), tr. du chinois Pierre Ryckmans, Gallimard, coll. Connaissance de l’Orient, 1970.
Lu Xun, Cris et Errances dans Nouvelles et poèmes en prose (nouvelles écrites dans les années 1920), tr. Sebastian Veg, Nouvelles et poèmes en prose, Paris, éd. Rue d’Ulm, 2015
Natsume Soseki, Je suis un chat (Wagahai wa neko de aru, 1905), tr. Jean Cholley, Paris, Gallimard/UNESCO, coll. Connaissance de l’Orient, 1978
Yang Jiang, Six récits de l’école des cadres (ganxiao liu ji 干校六级), tr. du chinois Isabelle Landry et Zhi Sheng, Paris, Christian Bourgois, 1983
Wang Xiaobo, Le Monde futur, tr. chinois Mei Mercier, Actes Sud, 2008
Jia Pingwa, La Capitale déchue, tr. du chinois Geneviève Imbot-Bichet, Stock, 1997
Wang Meng, Contes et libelles, tr. du chinois Françoise Naour, Paris, Gallimard, 2012
Gao Xingjian, Le Livre d’un homme seul, tr. du chinois Noël et Liliane Dutrait, L’Aube, 2001, rééd. Seuil, 2008
Fang Fang, Wuhan, ville close, tr. chinois Frédéric Dalléas et Geneviève Imbot-Bichet, Stock, coll. La cosmopolite, 2020
Film où les deux aires se croisent (Bei Dao / Mahmoud Darwich), Écrivains des frontières https://vimeopro.com/cinemeteque/cinemeteque/video/655740894
Le film sera visionné dans une séance commune le mardi 4 avril.
Modalités de validation :
Session 1 : contrôle continu :
- courte présentation orale dans le cadre d’une des séances
- réalisation d’une anthologie critique (pour la fin du semestre) : à rendre le 24 avril au plus tard, en version papier. Inutile de faire des frais de reliure.
Session 2 : dossier avec soutenance (oral, 20 min)
NB : ceux qui choisissent ce cours peuvent n’assister qu’à l’un des deux pans du cours (soit le lundi avec Eve de Dampierre, soit le mardi avec Céline Barral), soit 18h de TD au total, et ce afin de pouvoir prendre un bouquet culturel (Civilisation du monde arabe le lundi ou Etudes slaves le mardi). Chaque pan aura sa cohérence.
Littérature et culture ou latin
ECTS
6 crédits
Composante(s)
UFR Humanités
Période de l'année
Semestre 6
6LDRM511 Programme 1 Langue et culture latines
Composante(s)
UFR Humanités
Période de l'année
Semestre 6
- Langue et culture latines -
(cliquez sur le - bouton rouge - pour télécharger le descriptif du programme de l’année universitaire 2022-2023).
La femme dans le monde romain
Intervenante : Anne Bajard
6LDRE513 Programme 3 Littérature de jeunesse
ECTS
3 crédits
Composante(s)
UFR Humanités
Période de l'année
Semestre 6
- Littérature de jeunesse -
(cliquez sur le - bouton rouge - pour télécharger le descriptif du programme de l’année universitaire 2022-2023).
Le voyage dans la littérature de jeunesse
Intervenante : Myriam Tsimbidy
6LDRE512 Programme 2 Littérature francophone
ECTS
3 crédits
Composante(s)
UFR Humanités
Période de l'année
Semestre 6
- Littérature francophone -
(cliquez sur le - bouton rouge - pour télécharger le descriptif du programme de l’année universitaire 2022-2023).
Villes coloniales / métropoles postcoloniales : représentations littéraires et transferts culturels
Intervenante : Sylvère Mbondobari
Ecrire sur l'art et transfert, adaptations
ECTS
6 crédits
Composante(s)
UFR Humanités
Période de l'année
Semestre 6
Ecrire sur l'art
ECTS
3 crédits
Composante(s)
UFR Humanités
Période de l'année
Semestre 6
Transferts, adaptations, réécriture littéraires
ECTS
3 crédits
Composante(s)
UFR Humanités
Période de l'année
Semestre 6
PRE-PROFESSIONNALISATION - PARCOURS : didactique du FLES
ECTS
6 crédits
Composante(s)
UFR Langues et Civilisations
Période de l'année
Semestre 6
Méthodologie du FLE et élaboration de matériel pédagogique
Composante(s)
UFR Langues et Civilisations
Période de l'année
Semestre 6
Le cours s’organise autour de deux volets. Dans un premier temps, sera menée une réflexion sur la / les progression(s) d’apprentissage à partir des descripteurs du CECRL et de leur application dans quelques manuels actuels. Dans un deuxième temps, on travaillera sur la planification et l'élaboration d'activités pédagogiques à partir de différents supports écrits et oraux.
Apprentissages et activités interculturels
Composante(s)
UFR Langues et Civilisations
Période de l'année
Semestre 6
Ce cours vise à développer la compétence interculturelle des étudiants, par l’acquisition d’outils conceptuels propres à appuyer une démarche interculturelle, et à prendre conscience des enjeux interculturels dans l’enseignement / apprentissage d’une langue étrangère. En prenant connaissance de ce champ d’études et de pratiques spécifiques, l’étudiant sera en mesure de proposer des activités interculturelles aux apprenants de FLE, et de prendre en compte la dimension interculturelle dans la gestion des activités d’apprentissage.
PRE-PROFESSIONNALISATION - PARCOURS : Linguistique générale
ECTS
6 crédits
Composante(s)
UFR Langues et Civilisations
Période de l'année
Semestre 6
Linguistique et sciences connexes
Composante(s)
UFR Langues et Civilisations
Période de l'année
Semestre 6
Une partie du cours portera sur les sciences du langage au sens très large, à travers les grandes questions que pose l’étude des langues naturelles, et qui ont été soulevées par la philosophie, l’histoire, la sociologie, l’anthropologie, la psychologie, les neurosciences, voire l’informatique et les sciences de la communication. Une autre partie du cours portera plus spécifiquement sur les fondements de la linguistique moderne comme une science à part entière, à travers des linguistes comme Saussure, Jakobson ou encore Chomsky, en montrant là encore l’apport des sciences connexes dans la recherche actuelle en linguistique.
Approche typologique des langues : domaine japonais
Composante(s)
UFR Langues et Civilisations
Période de l'année
Semestre 6
Ce cours a pour objectif de présenter la langue japonaise dans ses différentes facettes (origines, histoire, écriture, phonologie, morphologie, syntaxe, pragmatique, etc.) à partir d'un point de vue typologique que l'on peut résumer par la question générale suivante : comment le japonais se situe-t-il par rapport aux autres langues du monde ?


